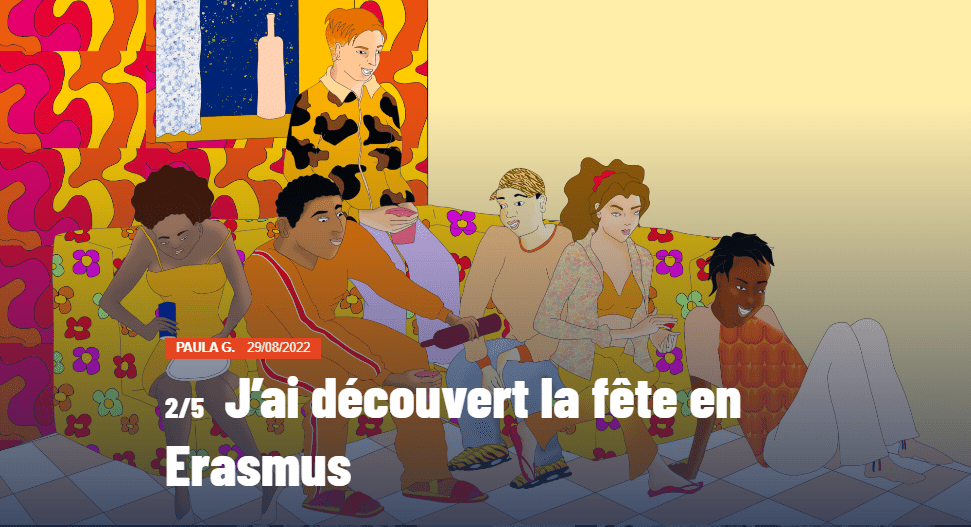1/5 Mes nuits blanches à Mayotte
Au téléphone avec une amie, je faisais le bilan de notre soirée de la veille. J’habitais à Mayotte, sur Petite-Terre, la plus petite des deux îles. L’autre, c’est Grande-Terre. À 15 ans, thé vert pour décuver sur la terrasse, je parlais très fort, m’esclaffant avec elle sur nos anecdotes de la nuit passée. Nous avions pris les scooters vers 23 heures, direction la barge – le bateau qui permet de traverser entre les deux îles pour aller au Mahaba, la boîte de nuit de Mamoudzou, la capitale. Nous avions passé la nuit là-bas à danser, pour ensuite rentrer au petit matin, quand nos esprits faiblissaient mais que les autres s’éveillaient.
Je me souviens qu’après avoir raccroché, mon père s’était emporté, profondément énervé par ce qu’il venait d’entendre. Je vous le donne dans le mille : j’étais évidemment allée sans la permission parentale dans cette ville de 70 000 habitants, à l’époque. C’était en 2015. Ça fait peu de personnes dit comme ça, mais quand on vit sur une île de 374 kilomètres carrés, ça fait un petit paquet de monde. La vision des choses n’a rien à voir.
Mon père et moi n’avions d’ailleurs pas la même. Pour lui, j’étais « totalement inconsciente » et je ne comprenais pas les enjeux du territoire où je vivais : c’était « dangereux ». J’avais envie de lui dire que je le comprenais, sans doute pas comme lui (il travaillait au service de l’immigration). Après avoir passé des heures dans les ruelles de Petite-Terre, comme explorant les entrailles d’une personne, je la connaissais d’une certaine manière, cette Mayotte. Et, pour moi, elle n’avait rien de dangereux, au contraire.
Un père au service de l’immigration
Tous les jours, mon père se rendait en barge à la sous-préfecture, à Mamoudzou. Au service de l’immigration, il voyait passer des centaines de dossiers, tous aussi durs les uns que les autres. Il les lisait et était chargé d’accepter ou non ces demandes d’admission au séjour. À Mayotte, l’immigration est très forte. Près d’un habitant sur deux est d’origine étrangère, un tiers étant des immigrés clandestins. Qui dit clandestinité dit hôpitaux surchargés, tensions sociales, mineurs isolés, bidonvilles dans les collines : en bref, je vivais dans le département le plus pauvre de France.
Alors, pour mon père, savoir que sa fille avait pu sortir sur cette grande île où les témoignages d’agressions paraissaient quotidiennement dans les médias, c’était bien trop grave et dangereux. Surtout que je devais, officiellement, me rendre dans une soirée à la caserne des gendarmes. Un lieu fermé, sécurisé, où les fonctionnaires s’attroupent pour vivre.
La nuit, une île qui semble reposée
Pendant ces deux années là-bas, je m’échappais plusieurs fois par semaine. Je partais en escapade voir mes amis pour m’enivrer et dormir chez eux et, parfois, je me baladais seule, écouteurs aux oreilles, dans les rues ou dans le stade de Pamandzi derrière chez moi. J’habitais cette commune, au sud de Petite-Terre, pas loin du seul aéroport existant. Le seul moyen, aussi, de s’échapper.
Mes escapades, c’était donc tout un procédé. Il fallait que l’alarme soit désactivée en amont, que je jette mes affaires pour m’habiller dans le garage, sur lequel ma fenêtre avec barreaux donnait. Les barreaux, c’était pour se protéger des cambriolages. C’était surtout les mzungus (les blancs, en mahorais) qui étaient visés. Puis, je sortais en pyjama, je m’habillais dehors rapidement et faisais en sorte de faire le moins de bruit possible. Une fois le portail passé, l’excitation d’une nuit de liberté s’offrait à moi.
Partant de la rue Sabili, j’allais donc au stade. La journée, les équipes de rugby s’entraînaient. Les joueurs, sueur au front et terre étalée sur les maillots, couraient et criaient. La nuit, c’était vide. Pas un bruit, seulement les animaux cachés qui sortaient discrètement, comme les raminagrobis, les petits félins de l’île. Et surtout, pas un seul danger à l’horizon.
On entendait les jeunes au loin faisant la fête, avec leurs canettes de bière autour des mabawas – des cuisses de poulet – sur le barbecue dans les farés. Pas loin du stade, il y avait la mer. Elle était partout en fait, nous encerclant de sa double barrière de corail. Comme les Mahorais ne se baignent que très peu, car les djinns peuvent se cacher dans l’eau, c’était désert la nuit. Les expatriés venus profiter des plages de l’île, eux, étaient rentrés.
L’envie de ne pas diaboliser Mayotte
Dans les médias, ce 101e département français est qualifié d’île « de l’insécurité ». Agressions, vols, cambriolages, jeunesses violentes. Un champ lexical négatif, utilisé certes à raison, mais qui ne faisait pas sens à mes yeux. Car, à travers eux, je voyais une île, la nuit tombée, calme et sereine. Une île plus ou moins éclairée, mais pas plus sombre.
Du fameux stade de Pamandzi en allant dans l’autre commune de Petite-Terre, Labattoir, les rivalités existaient entre les habitants de ces deux « quartiers ». Surtout entre collégiens. Mais, la nuit, les épiceries éclairaient les trottoirs, sur lesquels traînaient la jeunesse mahoraise, toutes communes confondues. Comme si les limites étaient floues.
SÉRIE 2/5 – Paula a grandi au calme dans une petite ville de campagne. C’est en Pologne, en Erasmus, qu’elle découvre l’effervescence des soirées.
Plus loin, dans le nord de Petite-Terre, près de l’embarcadère pour accéder à la barge, les scooters garés s’accumulaient autour de 23 heures. C’est là que réside le sous-préfet, à l’époque Seymour Morsy, nommé en 2014 après avoir été chef du cabinet de la ministre de la Justice Elisabeth Guigou. Il vivait alors sur « Le Rocher », comme on l’appelait.
Mes amis mahorais vivaient dans des bangas – les maisons de tôle, souvent à plusieurs, à beaucoup. Alors, sortir le soir était pour eux un exutoire. Et les accompagner était devenu une habitude. Discuter avec eux d’une île sur laquelle ils ont grandi révélait une toute autre facette. Leurs maux effaçaient ceux des médias : « rétention », « violences », ou « jeunesse abandonnée ». Et je découvrais de nouveaux mots, ceux qui qualifient une Mayotte de nuit, apaisée.
Maëlle, 20 ans, étudiante, Paris
Illustration © Léa Ciesco (@oscael_)
En soirée, évitons le danger
Faire la fête, c’est cool. En limitant les risques, c’est mieux ! Si vous et/ou vos ami·es consommez des drogues en soirée, voici quelques recommandations pour réduire les risques :
– Boire régulièrement de l’eau, en petite quantité
– Éviter de consommer seul·e, plutôt avec des personnes de confiance qui prendront soin de vous en cas de problème
– Espacer les prises / les verres
– Ne partager aucun matériel d’injection et utiliser du matériel stérilisé pour éviter la transmission de maladies
– Éviter de mélanger plusieurs substances. À noter : l’alcool amplifie l’effet des drogues
– Faire attention à la composition des produits : beaucoup de drogues sont coupées avec des substances dangereuses.
Et surtout : ne prenez pas de substances sous pression. Personne n’a le droit de vous forcer à vous droguer.
→ Pour avoir le détail des effets des différentes substances et obtenir des conseils pour réduire les risques, l’association Techno Plus vous informe ici.
→ Si votre consommation vous inquiète ou si vous avez des questions, vous pouvez appeler Drogues Info service : 0 800 23 13 13. Il existe aussi des consultations gratuites et anonymes. Voici la liste en Île-de-France.
En cas d’urgence, appelez le 15 ou le 18