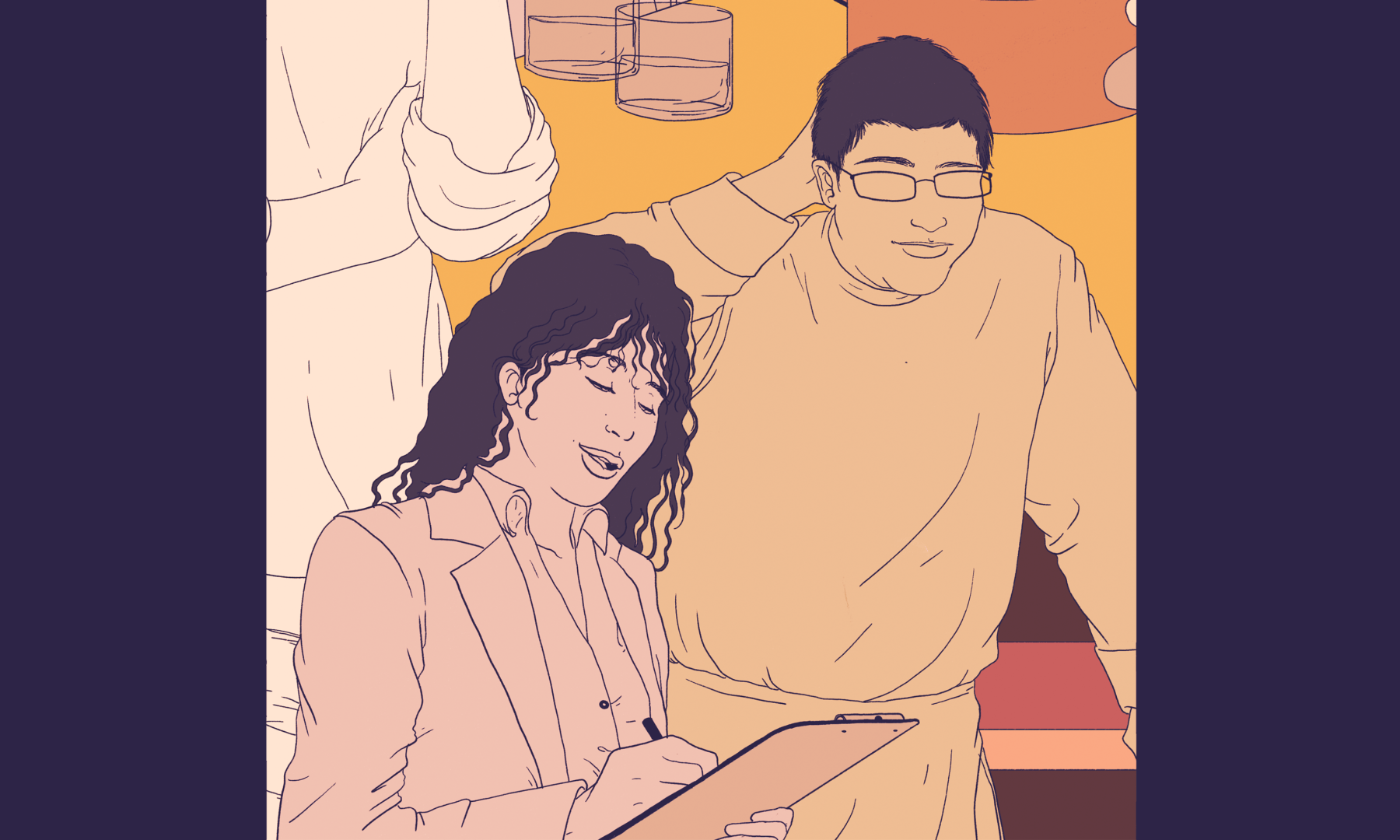2/4 Mon taf, ce lieu de fête
Je connaissais déjà le hangar réaménagé par des architectes où j’ai travaillé deux ans. Il est, à présent, un lieu culturel et nocturne. C’est à la fois une salle de concert, un lieu d’exposition et un restaurant qui se transforme en boîte la nuit venue. Haut lieu de festivité de ma ville, je l’avais déjà arpenté lors de soirées au club : la programmation est pointue et les artistes reconnus. Je suis assez étonné lorsque j’y obtiens le poste de plongeur. Le chef m’accueille pour mon entretien un pétard à la main à 10 heures du matin. Le courant est fluide mais l’adaptation rude : la première semaine, je travaille soixante heures à la plonge.
J’apprends alors que toutes mes heures supplémentaires sont payées, plus que le SMIC et en liquide. Je ne fait pourtant aucune économie pendant cette période : je gagne en moyenne 1 700 euros et, à 20 ans, le gain, c’est la fête.
Travail manuel et fête mentale
Quelques mois passent, puis mon poste évolue vers le métier de commis de cuisine. Mes collègues cuisiniers m’estiment comme un des leurs. Comme ils me le disent, cette cuisine c’est le « zoo ». Il n’y a pas vraiment de hiérarchie, une énorme enceinte est placée au centre et l’organisation générale laisse à désirer : il faut juste faire son travail et le faire bien, tant que tu es sur le pont le matin afin de préparer le service du midi. Cela s’avère être d’une récurrence et d’une normalité choisie et voulue, aucun doute ne me parvient à l’époque, et aucun regret à présent.
Auparavant, j’avais fait quelques saisons en tant qu’animateur de colonie, et si je trouvais l’exercice fatigant, le travail physique comme je l’expérimente en cuisine, cru et permanent, est une réelle nouveauté. Les mains de travailleurs, ce sont des mains avec des cloques et des coupures. Les miennes sont drues et épousent la forme de mon couteau de cuisine. Le travail est éreintant, les bancs de la faculté me paraissent être à une éternité. Dans la chaleur étouffante des cuisines du hangar, la musique est vrombissante. L’ambiance valdingue entre esprit festif et stress du service. Avant les shifts du midi et du soir, la mise en place doit être terminée et nous sommes réglés comme des horloges. Un exercice presque militaire, mais en musique et souvent alcoolisé pour le service du soir. C’est le métier qui rentre.
650 euros de poudre
Une solidarité et une proximité apparaissent petit à petit. Nous sommes entre trois et six en cuisine selon les soirées. Parfois, au lieu d’être au travail, j’ai l’impression d’être en soirée. Les basses du club, situées à côté de la cuisine, font vibrer les murs. Et l’alcool aussi. La pinte d’avant le « jus » du service, puis les cocktails et les shooters pendant.
Régulièrement de la cocaïne aussi. Comme ce premier matin, où un groupe réserve le restaurant et une partie du club. Nous travaillons en continu jusqu’à minuit. Lorsque je me change dans les vestiaires pour enfiler ma veste de cuisine, mon supérieur vient me proposer une ligne pour le petit-déjeuner. Cela se répète plusieurs fois les grosses semaines. L’habitude s’installe – très – facilement. Allant jusqu’à dépenser 650 euros, un mois de décembre, seulement pour la poudre. Dans ce hangar, les travers prennent parfois la place de mon objectif initial : faire une pause et reprendre des études.
En dehors du travail, mes amis ont les mêmes comportements pendant les fêtes. Mais, eux, ils sont étudiants. Je n’ai jamais eu le sentiment de perdre les pédales, à l’inverse de certains, et généralement les soirées s’éternisent chez moi. Sûrement que nos milieux sociaux nous permettent d’agir de la sorte en nous disant que cela n’est qu’un passage. La dépendance est palpable mais tolérée ; tant qu’individuellement je m’y retrouve, que je travaille et que je ne déprime pas – ce qui s’avère pour ce dernier point souvent délicat.
Quelques angoisses le dimanche, un léger brouillard dans ma tête jusqu’au mardi… mais le milieu de semaine arrive rapidement. Boire et consommer reste la norme, une sorte de répartition des tâches, un contrat officieux. Ce milieu professionnel est difficilement dissocié des travers de la fête.
Un dénouement tout en longueur
Ma certitude de virer de bord apparaît lorsque je vois des collègues partir en burn-out, souvent des travailleurs ayant dépassé la trentaine et moins adaptés à ce rythme. L’avantage est de rencontrer des personnalités et des parcours de vie très différents du mien. Des cercles sociaux dans lesquels faire des études supérieures n’est pas la norme.
Série 3/4 – À côté de ses études, Louise s’est retrouvée à gérer le restaurant où elle bossait. Une responsabilité bien trop importante pour son poste.
Je recommence une licence, dans une faculté privée qui offrait, pour une reprise, un réel accompagnement, avec peu de cours magistraux et des petites promotions. Redevenu un étudiant aux moyens limités, redescendre s’avère compliqué. À l’époque, il est délicat de faire la fête « seulement » avec de l’alcool, sans rien consommer. Une année est nécessaire, avec quelques périodes fastes. Puis, mes envies passent, et d’autres opportunités viennent aujourd’hui combler ces désirs de débauche.
Vincent, 24 ans, étudiant, Nanterre
Illustration © Merieme Mesfioui (@durga.maya)
La restauration, travailler plus pour gagner moins
237 000 salarié·e·s en moins en un an
Entre février 2020 et février 2021, le secteur de l’hôtellerie-restauration a perdu 237 000 employé·e·s, notamment à cause des fermetures d’établissements liées à la crise sanitaire. Mais depuis leur réouverture, le secteur peine à recruter : plus de 100 000 emplois sont actuellement à pourvoir.
1 432 euros nets par mois pour un·e serveur·euse
L’une des raisons de ce désamour : des salaires (trop) bas, qui dépassent rarement le Smic en début de carrière. Un serveur qui débute et qui travaille trente-neuf heures par semaine (en théorie, car en pratique le nombre d’heures supplémentaires explose) gagne 1 432 euros nets par mois. Même chose pour un·e plongeur·euse ou un·e cuisinier·e.
Des conditions de travail infernales
Les nombreuses contraintes imposées par le secteur participent à cette crise de vocation : horaires à rallonge, travail le soir, les week-ends et les jours fériés, stress, pression, rapidité et tâches répétitives. Les cuisinier·e·s et les employé·e·s de l’hôtellerie-restauration occupent respectivement les places une et deux du classement des dix métiers les plus pénibles en France.