En Syrie, je m’étais habitué à la guerre
Quand ils se tiraient dessus, ma mère ne me laissait pas dormir dans ma chambre. J’habitais en Syrie, il y avait une base militaire de l’armée du pays juste en face. L’armée libre essayait de libérer la ville. Elle se positionnait derrière mon immeuble ou sur le toit. Pour ne pas recevoir une des balles, je dormais dans la chambre de mes parents. On dormait à cinq dans leur lit, et on passait la nuit à parler et rigoler. Dehors, il y avait deux armées qui s’affrontaient. On avait peur mais on essayait de la dépasser.
J’étais en Syrie jusqu’à mes 11 ans. J’habitais à Damas, la capitale, dans un appartement avec mon père, ma mère et mes deux frères. Une vie normale, comme ici en France : on se réveille, on va en cours, les grands vont au travail… On voyageait, on passait des vacances ensemble, on rendait visite à la famille. Une vie normale… Sauf que depuis le 15 mars 2011, tous les soirs, l’armée du pays (l’armée de l’État) et l’armée qui essayait de libérer le pays se tiraient dessus. Il y avait aussi Daesh, d’autres pays, des armées de l’Iran, de la Russie… Moi, je ne les voyais pas, pour moi ce n’était que deux armées. J’en voyais rarement d’autres car là où j’étais le plus, ce n’était que des villes encore occupées par les armées de l’État. La guerre en Syrie, quand j’y réfléchis, ce n’était pas normal.
Faire coucou aux tanks tous les matins
Un matin, j’attendais mon bus, c’était la rentrée, et là je vois onze tanks passer devant moi avec des militaires dessus. Je les ai comptés. Je me suis caché sous une voiture parce que j’ai eu peur. Après, je me suis dit : s’ils me voient caché, ils vont croire que je suis recherché et ils vont me tirer dessus… Du coup, je me suis levé et je leur ai fait coucou. Et ils m’ont répondu ! J’étais content mais j’avais peur quand même. Après ça, chaque matin, deux tanks passaient pour traverser la ville et je leur faisais coucou tous les matins. C’est comme ça que c’est devenu normal pour moi.
Quand on circulait en voiture, tous les cinq kilomètres, les militaires du pays fouillaient les voitures, regardaient la carte d’identité des passagers pour vérifier s’ils étaient recherchés. On faisait la queue en voiture : c’était partout comme ça et ça pouvait durer cinq minutes comme une heure. C’était chiant, c’était normal : c’était comme ça. C’était comme un feu rouge ici en France.
Il y avait des tanks, des mecs armés, des armes partout… On n’était jamais en sécurité en vrai, mais je n’avais pas peur de les voir, je ne sais pas pourquoi.
Après la violence du voyage et de l’intégration au pays d’accueil, de nombreuses personnes exilées doivent digérer les traumatismes vécus. Des séquelles psychologiques qui restent malgré les années qui passent. InfoMigrants a interviewé Maria Prochazkova, psychothérapeute à Berlin, qui accompagne les survivants de guerre et les personnes victimes de torture.
Des centaines de milliers de Syriens ont trouvé refuge en Allemagne depuis le début de la guerre il y a 10 ans. Mais pour beaucoup, il est impossible de tourner la page des horreurs vécues pendant le conflit et l’exil forcé.https://t.co/jCYkkMqJYp
— InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) April 16, 2021
Le jour où j’ai eu le plus peur, c’était chez un ami de mon père. Un missile avait été tiré juste à côté de son immeuble. Il est passé au-dessus du bâtiment dans un très grand bruit et a fait trembler tout le bâtiment. L’armée qui avait tiré ce missile avait prévenu tous les habitants, mais ils avaient oublié de nous prévenir, nous. Ce jour-là, j’ai vu ma mère et mes frères pleurer de peur. Mais moi, je n’ai pas pleuré… Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. J’étais sous le choc au début, puis je suis parti regarder par la fenêtre et j’ai vu le grand camion à missile avec lequel ils ont tiré, il était juste en bas du bâtiment.
Nos vies détruites
Un jour, Daesh était en bas de chez ma grand-mère. Ça se voyait que c’était eux : les drapeaux, les vêtements et tout… Je n’avais pas peur d’eux, alors que j’aurais dû. J’étais jeune. Mes parents, eux, avaient peur pour nous. Je ne savais pas trop si ça préoccupait les gens, la population, mais quand j’y pense maintenant, la guerre elle détruit des gens, des vies, des familles…
Mon père a perdu son travail, ses employés… Puis, on a perdu notre maison que mon père avait construite lui-même. On avait déménagé dedans au début de la guerre. Un an après, en visite chez ma grand-mère, on regardait la télé et on a vu que ma ville se faisait bombarder. L’armée libre essayait de faire sortir l’armée de l’État de la ville. Ce jour-là, ils n’ont pas réussi…
Deux jours après, mon père est parti dans la maison pour essayer de récupérer quelques affaires et pour voir si l’état de la maison était bien : l’armée était rentrée, elle avait volé et cassé tout ce qu’il y avait dedans… Ils avaient sorti toutes les photos et tout ce qui était rangé, et les avaient jetés partout.
Une dizaine de jours après, on est revenus. J’ai vu toute ma ville détruite : les rues vides, les bâtiments bombardés… On a essayé de se réinstaller mais il n’y avait pas d’électricité, pas d’eau, rien du tout. Du coup, on est revenus chez ma grand-mère. Moins d’un an après, on a reçu des photos de la ville avec notre bâtiment complètement détruit.
Encore un an après, on était en France.
Réaliser une fois parti
Quand j’ai vu la vie d’ici par rapport à la vie de là-bas, je me suis rendu compte que ce n’était pas normal. En France, c’est plus calme et avec plus de vie. Ça m’a aidé à passer à autre chose, à m’intégrer. On ne peut pas ne pas penser à ça, ça vient tout seul. On essaie juste de ne pas y penser, mais sans y arriver.
Tout ça, j’étais petit. Si j’avais été plus grand (16–19 ans) à « un feu rouge », j’aurais pu me faire prendre. L’armée, là-bas, c’est obligatoire à 18 ans. Ça ne m’aurait pas posé problème s’il n’y avait pas la guerre. C’est pour ça qu’on est venus en France. Ce sont mes parents qui ont pris la décision : la démarche nous a pris à peu près un an, beaucoup de réflexions, beaucoup d’hésitations, les papiers, l’argent, la famille, le voyage…
SÉRIE – Il n’y a pas que la guerre qui incite à quitter son pays pour un avenir meilleur. Santé, argent, discriminations… Quatre jeunes mineur·e·s isolé·e·s retracent les raisons concrètes de leur migration.
On s’en sort heureux parce qu’on est sortis en vie. On n’a pas perdu beaucoup de famille, surtout du matériel. Maintenant, en écrivant tout ça, je me rends compte que j’ai vécu des choses vraiment très graves pour un enfant. Et il y a des enfants et des familles qui vivent mille fois pire, même si j’ai raconté même pas 5 % de ce que j’ai vécu… Mais si maintenant il m’arrive des choses graves, je vais penser à ça… Et mes problèmes vont devenir plus petits.
Owes, 18 ans, lycéen, Rubelles
Crédit photo Pexels // CC Anete Lusina









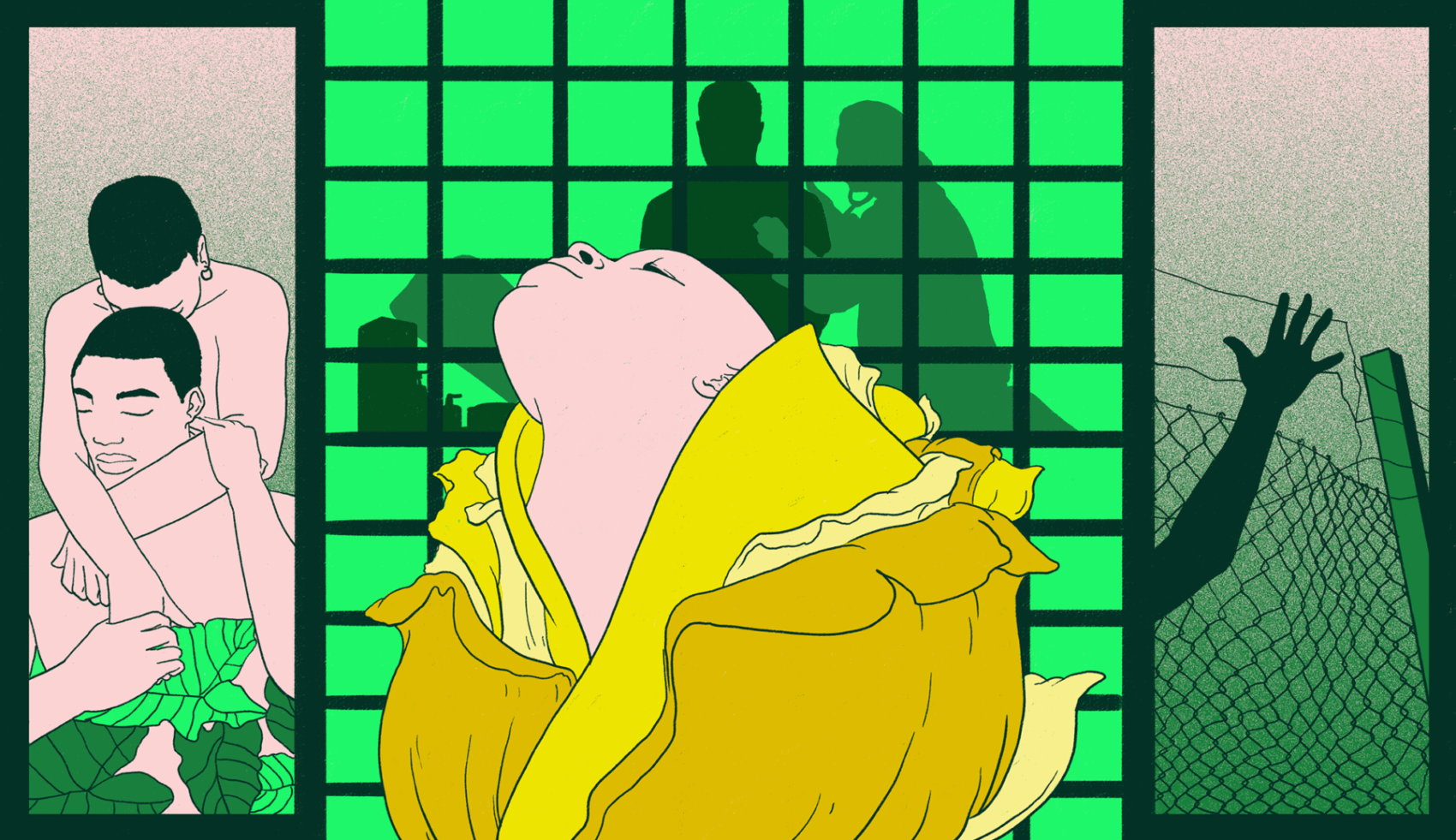



Courage fragin !